Interrogations contemporaines du modèle walrassien
A l’occasion de la sortie d’un livre collectif d’économistes contemporains, Pascal Bridel, Professeur d’économie politique à l’Université de Lausanne et membre de l’Association internationale Walras, a exposé l’opinion de ces économistes sur la thèse walrassienne. Et a souligné l’importance théorique de l’équilibre général. Roger Guesnerie se demande comment convaincre que « l’âme » de Walras a un avenir aujourd’hui . Selon lui, il faut réexaminer la démarche du « tâtonnement » et reconstruire le modèle des anticipations car elles ne sont pas toujours rationnelles. De son côté, Kenneth Arrow montre que le modèle s’effondre s'il y a un défaut de l’information. De même, André Orléan, directeur de recherches au CNRS, revenant sur la conception de la valeur chez Walras, pointe du doigt une omission. Selon le modèle walrassien, les objets ont une utilité en eux-mêmes, ce qui entraîne des échanges. Echanges qui se coordonnent en fonction de l’utilité maximale de chacun des individus. Walras occulte ainsi le fait que l’échange produit les besoins.
De l’idéal à son application sociale
Revenir sur la nature et la conception sociale du raisonnement Walrassien est indispensable pour mieux le comprendre. André Orléan et Jean-Pierre Potier, professeur de sciences économiques à l’Université Lumière Lyon-2, s’accordent sur la nature du raisonnement walrassien : l’abstraction et la conceptualisation en sont les maîtres mots. Léon Walras définissait son travail comme « une science physico-mathématique », « pas dans la méthode expérimentale ». En définitive, Walras a suivi la méthode weberienne de l’idéal-type, en conceptualisant les objets (« valeur », « production », « individu »….) de son modèle. Cette démarche pose la question de son rapport au réel : tout comme pour le modèle weberien, la tendance des économistes est d’appliquer la théorie de l’équilibre général au monde réel alors qu’elle n’est qu’un idéal vers lequel il faut tendre. Et Jean-Pierre Potier le rappelle : « Walras pense que le but final de la science est de rapprocher la réalité d’un certain idéal ». C’est donc pour cela que Léon Walras a réfléchi sur la question sociale car il pensait pouvoir la réduire « scientifiquement ». Se proclamant « socialiste scientifique », il cherchait à permettre l’efficacité économique sans nuire à la justice sociale. Il prône des réformes sociales comme le rachat des terres par l’Etat. Car il estime que l’on ne peut pas attribuer tous les droits de propriété aux individus. En effet, pour respecter l’inégalité des positions personnelles, les hommes doivent posséder en commun les ressources naturelles. L’option envisagée par Walras est l’achat des terres par l’Etat au prix du marché et la location aux particuliers et entrepreneurs.
L'alliance de l'efficacité économique et de la justice sociale
Ensuite, Léon Walras s’est attaché à la poursuite de l’efficacité économique en envisageant des exceptions au principe de la libre-concurrence. Dans les domaines d’intérêt général, la libre-concurrence ne doit pas agir et c’est l’Etat qui veille à leur bon fonctionnement : les services publics, à savoir les fonctions régaliennes (Administration, Justice, Défense Nationale, Instruction Publique et Recherche Scientifique), les monopoles naturels (mines, eau et gaz) et les chemins de fer. A noter que Walras n’admet pas l’Etat-Providence car c’est un socialiste libéral. Il souhaite, d’un côté, l’instauration de conditions de travail pour éviter le dumping social et l’équilibre du marché, et, d’un autre côté, la poursuite des initiatives individuelles. L’équilibre général de Walras reste, de l'avis de tous les intervenants, le seul modèle théorique qui permet d’atteindre efficacité économique et justice sociale.
Photo : source: cepa.newschool.edu

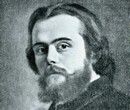 Chaque année depuis leur création, les Jéco rendent hommage à un économiste. Cette année, Léon Walras est à l’honneur, alors que l’on célèbre le centième anniversaire de sa mort (5 janvier 2010). Une occasion de redécouvrir le fondateur de la théorie moderne de l’équilibre général à travers certaines de ses réflexions.
Chaque année depuis leur création, les Jéco rendent hommage à un économiste. Cette année, Léon Walras est à l’honneur, alors que l’on célèbre le centième anniversaire de sa mort (5 janvier 2010). Une occasion de redécouvrir le fondateur de la théorie moderne de l’équilibre général à travers certaines de ses réflexions.